Noblesse et Chevalerie
Rares sont les films de cinéma qui incitent les êtres humains à l’élévation vers un Idéal de Noblesse, d’Honneur et de Chevalerie [article protégé par mot de passe; nécessite d’être enregistré et connecté, et aussi de connaître le mot de passe (à demander à la Rédaction par le formulaire de contact)], mais – bien que la production du cinéma contemporain (« comptant pour rien »!) soit, à de rares exceptions, globalement des plus affligeantes – il y en a tout de même quelques-uns…
Élever les êtres humains vers la Noblesse, la Beauté et la Pureté, tel devrait d’ailleurs être, d’une façon générale, le rôle du cinéma, capable de générer des processus dans la matière fine.
Ivanohé
Prenons, par exemple, le film « Ivanohé », de Richard Thorpe (également réalisateur du film « Les Chevaliers de la Table Ronde » et aussi de « Les Aventures de Quentin Durward », du même Walter Scott) basé sur le roman « Ivanohé » du romancier écossais Walter Scott.
Arte le présente ainsi:
« Avec Elizabeth Taylor et Robert Taylor, un merveilleux film de chevalerie réalisé par Richard Thorpe, l’un des artisans les plus doués d’Hollywood pour façonner des œuvres flamboyantes mêlant aventures et grands sentiments.
De retour de croisade, le chevalier Ivanhoé retrouve une Angleterre sous le joug tyrannique de Jean sans Terre. Le félon s’est emparé du trône en l’absence de Richard Cœur de Lion, parti lui aussi combattre en Terre sainte. Or, sur le chemin du retour, le roi Richard a été capturé par Léopold V d’Autriche. Ivanhoé fait le serment de réunir la rançon réclamée pour la libération de son souverain. Aidé de son fidèle écuyer Wamba, le chevalier commence sa quête. En sauvant d’une embuscade un patriarche juif, Isaac d’York, il lui jure de mettre fin aux persécutions infligées à son peuple contre son aide financière… »
Batailles du cœur
Amour et action: au cœur des années 1950, Richard Thorpe fut un des artisans les plus doués d’Hollywood pour façonner des œuvres flamboyantes mêlant grands sentiments et codes du film d’aventures. Ivanohé s’avère l’une de ses plus belles réussites, rejoignant dans son panthéon personnel Le prisonnier de Zenda ou Les chevaliers de la Table ronde. Le tournoi d’Ashby et l’attaque du château de Torquilstone sont ici des séquences d’anthologie, des modèles du genre. Mais Ivanohé raconte aussi une histoire d’amour splendide et cruelle, dans laquelle Elizabeth Taylor resplendit. »
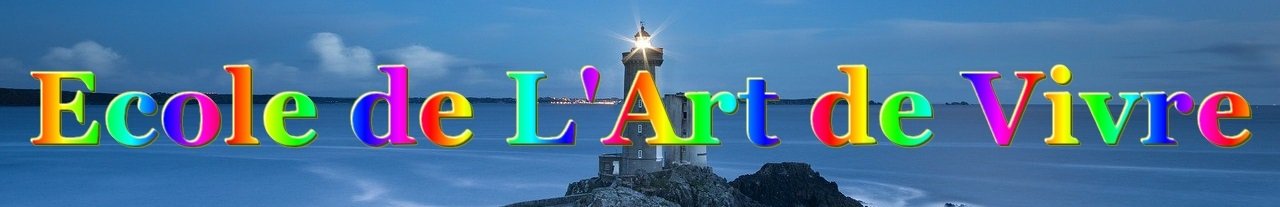


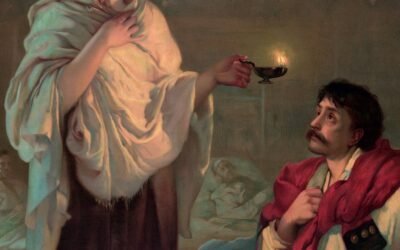


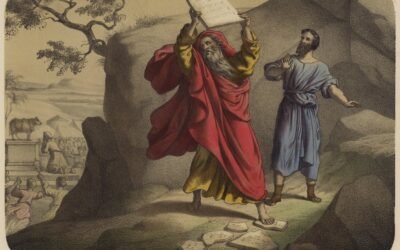


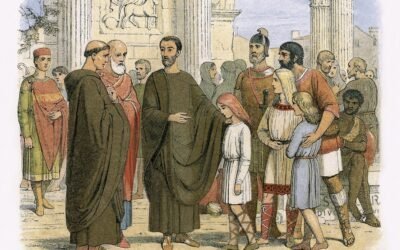

Si l'amour du prochain rejoignait l'amour que l'être humain peut se porter à lui-même, il ne pourrait en résulter qu'une…
La pratique de la CNV est en soi très utile pour objectiver le processus et la prise de conscience de…
MISERERE D'ALLEGRI Une merveilleuse Prière vers le très haut. Mozart savait ce qu'il faisait dans la transcription de cette œuvre.
MISERERE D'ALLEGRI C'est une superbe prière qui monte vers les hauteurs. Mozart savait ce qu'il faisait lors de la transcription…
Il y a la discrétion qui tient du bon vouloir, mais telle qu'elle est expliquée ici, la dissimulation est le…
Les vaniteux sont la proie des flatteurs. Flatterie et vanité, toutes filles des ténèbres, ainsi le mal s'oppressse. Tâchons de…
Gratitude 🙏.
UN FILM à faire connaitre absolument, notamment parmi les Chrétiens.
Gratitude.
Il n'est rien à ajouter à de telles paroles de Vérité qui résonnent comme une Exhortation à s'engager corps et…